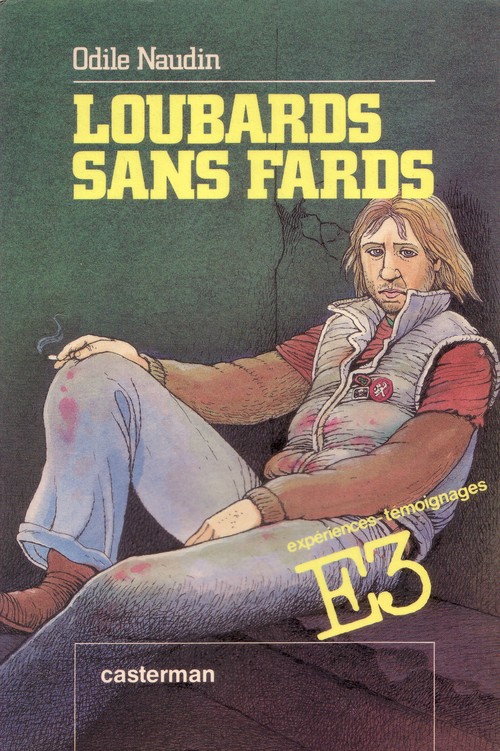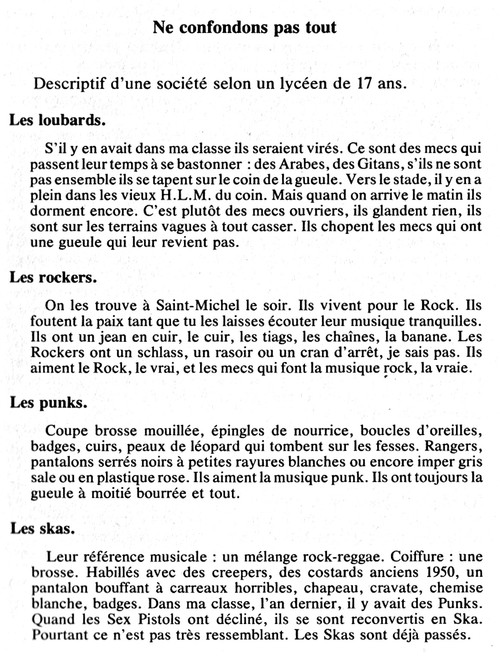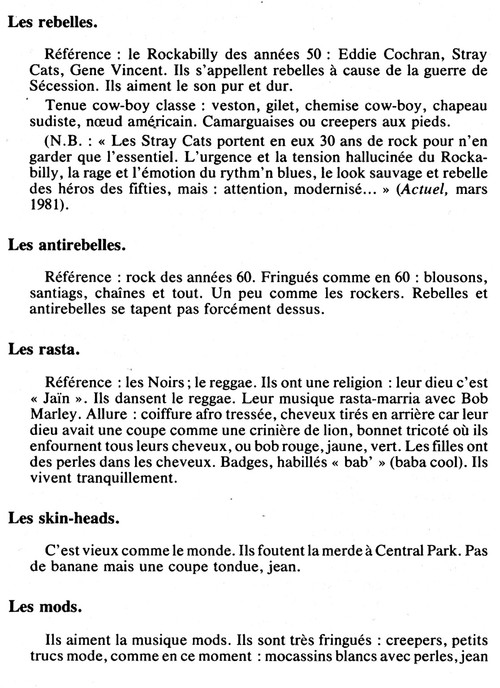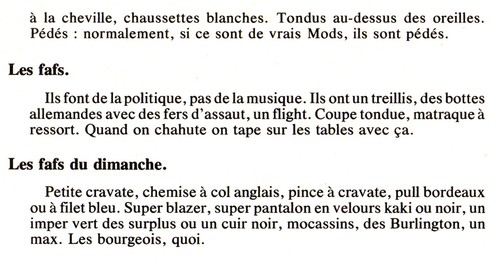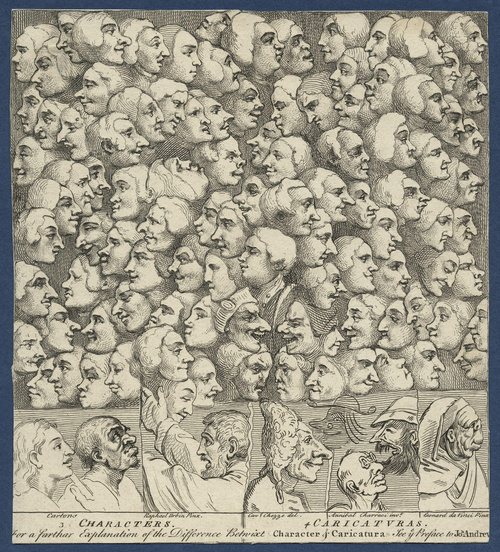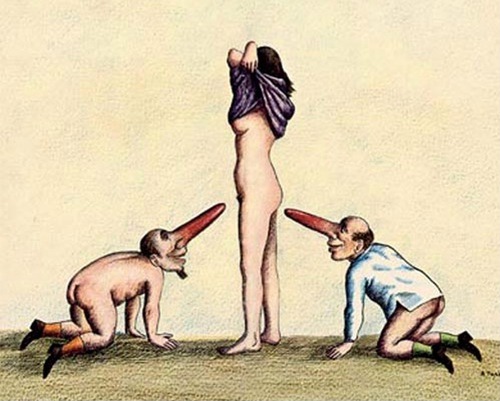«
« Qu'est-ce qu'un supplice? "Peine corporelle, douloureuse, plus ou moins atroce", disait Jaucourt; et il ajoutait: "C'est un phénomène inexplicable que l'étendue de l'imagination des hommes en fait de barbarie et de cruauté." Inexplicable, peut-être, mais certainement pas irrégulier ni sauvage. Le supplice est une technique et il ne doit pas être assimilé à l'extrémité d'une rage sans loi. Une peine, pour être un supplice, doit répondre à trois critères principaux: elle doit d'abord produire une certaine quantité de souffrance qu'on peut sinon mesurer exactement, du moins apprécier, comparer et hiérarchiser; la mort est un supplice dans la mesure où elle n'est pas simplement privation du droit de vivre, mais où elle est l'occasion et le terme d'une gradation calculée de souffrances: depuis la décapitation - qui les ramène toutes à un seul geste et dans un seul instant: le degré zéro du supplice - jusqu'à l'écartèlement qui les porte presque à l'infini, en passant par la pendaison, le bûcher et la roue sur laquelle on agonise longtemps; la mort-supplice est un art de retenir la vie dans la souffrance, en la subdivisant en "mille morts" et en obtenant, avant que cesse l'existence "the most exquisite agonies".
Le supplice repose sur tout un art quantitatif de la souffrance. Mais il y a plus: cette production est réglée. Le supplice met en corrélation le type d'atteinte corporelle, la qualité, l'intensité, la longueur des souffrances avec la gravité du crime, la personne du criminel, le rang de ses victimes. Il y a un code juridique de la douleur; la peine, quand elle est suppliciante, ne s'abat pas au hasard ou en bloc sur le corps; elle est calculée selon des règles détaillées: nombre de coups de fouet, emplacement du fer rouge, longueur de l'agonie sur le bûcher ou sur la roue (le tribunal décide s'il y a lieu d'étrangler aussitôt le patient au lieu de le laisser mourir, et au bout de combien de temps doit intervenir ce geste de pitié), type de mutilation à imposer (poing coupé, lèvres ou langue percées). Tous ces éléments divers multiplient les peines et se combinent selon les tribunaux et les crimes: "La poésie de Dante mise en lois", disait Rossi; un long savoir physico-pénal, en tout cas.
Le supplice fait, en outre, partie d'un rituel. C'est un élément dans la liturgie punitive, et qui répond à deux exigences. Il doit, par rapport à la victime, être marquant: il est destiné, soit par la cicatrice qu'il laisse sur le corps, soit par l'éclat dont il est accompagné, à rendre infâme celui qui en est la victime; le supplice, même s'il a pour fonction de "purger" le crime, ne réconcilie pas; il trace autour ou, mieux, sur le corps même du condamné des signes qui ne doivent pas s'effacer; la mémoire des hommes, en tout cas, gardera le souvenir de l'exposition, du pilori, de la torture et de la souffrance dûment constatés. Et du côté de la justice qui l'impose, le supplice doit être éclatant, il doit être constaté par tous, un peu comme son triomphe. L'excès même des violences exercées est une pièce de sa gloire: que le coupable gémisse et crie sous les coups, ce n'est pas un à-côté honteux, c'est le cérémonial même de la justice se manifestant dans sa force. De là sans doute ces supplices qui se déroulent encore après la mort: cadavres brûlés, cendres jetées au vent, corps traînés sur des claies, exposés au bord des routes. La justice poursuit le corps au-delà de toute souffrance possible.
»
Surveiller et punir, Michel Foucault, 1975.
(Picture: La Chatte Sur Un Doigt Brûlant, 1975)